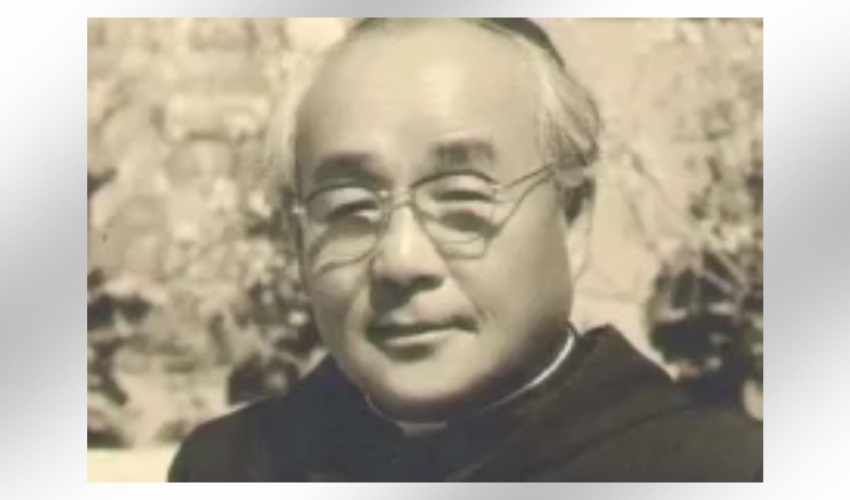La communauté catholique coréenne célèbre une étape décisive : le Saint-Siège a donné son « Nihil obstat » au processus de béatification du père Leo Bang Yu-ryong (1900-1986), fondateur de la vie monastique coréenne. L’annonce a été faite par Monseigneur Job Koo Yoo-bi, évêque auxiliaire de Séoul et président de la Commission diocésaine pour la béatification et la canonisation, qui a exprimé sa joie en confirmant l’ouverture prochaine de la phase diocésaine.
Le père Leo Bang, considéré aujourd’hui comme un véritable « ancêtre de la foi », a profondément marqué l’histoire de l’Église en Corée. Né en 1900 dans une famille catholique, il a grandi dans un contexte de persécutions, d’abord sous la dynastie Joseon puis sous l’occupation japonaise. Ordonné prêtre en 1930, il s’est distingué par un ministère pastoral fécond, marqué par le renouveau liturgique et l’attention aux jeunes, mais aussi par son discernement en faveur de la vie religieuse.Constatant l’absence d’ordres autochtones adaptés à la culture coréenne, le père Bang a fondé, en 1946 à Kaesong, la première congrégation religieuse féminine coréenne, les Sœurs des Bienheureux Martyrs Coréens. Par la suite, il a également fondé en 1953 la première congrégation masculine autochtone, ainsi que d’autres branches séculières et communautaires, toutes enracinées dans la spiritualité des martyrs coréens.
Lire aussi
Sa vision reposait sur une conviction forte : la foi devait s’enraciner dans la langue, la pensée et la culture de la nation coréenne. La spiritualité qu’il a transmise, centrée sur le silence, la prière et le don total au prochain, continue d’animer aujourd’hui des milliers de religieux, religieuses et laïcs.
Longtemps surnommée Royaume Ermite, la Corée a résisté aux influences extérieures, ce qui explique la lente arrivée de l’Évangile et la vigueur des traditions confucéennes et bouddhiques.Fait unique en Asie, le catholicisme coréen naît au XVIIIe siècle sans missionnaires, des lettrés découvrant à Pékin les ouvrages des jésuites et ramenant livres, chapelets et croix.En 1784, Ri Seung-hun est baptisé à Pékin sous le nom de Pierre, il introduit la foi à Séoul où les premiers catéchumènes s’organisent et se baptisent entre eux, avant de comprendre l’irrégularité de ces gestes.Le premier prêtre à entrer durablement est le Chinois Jacques Zhou, arrivé en 1795, il administre les sacrements, fonde des confréries et subit le martyre en 1801.S’ouvrent alors de grandes persécutions, en 1801 puis surtout en 1839, 1846 et 1866, où des centaines de fidèles, femmes et hommes de toutes conditions, confessent le Christ jusqu’au sang.Pour répondre à cet essor paradoxal, Rome érige en 1831 le Vicariat apostolique de Corée, confié aux Missions Étrangères de Paris, avec Mgr Barthelemy Bruguière comme premier vicaire.Après sa mort aux portes du pays, les Pères Pierre Maubant et Jacques Chastan pénètrent en Corée, structurent la communauté et seront eux-mêmes martyrs, à l’exemple du jeune prêtre coréen André Kim Tae-gon en 1846.
Au fil du XIXe siècle, la foi se diffuse dans les villages, portée par des laïcs catéchistes, dans un milieu rural, montagnard, marqué par le culte des ancêtres et des pratiques superstitieuses que l’Évangile vient purifier.
Le XXe siècle voit la reconnaissance de cette fécondité spirituelle, jusqu’à la canonisation par saint Jean Paul II en 1984 de 103 martyrs de Corée, signe que l’Église locale est née de la croix.C’est dans cet humus, langue, culture et mémoire des martyrs, que s’inscrit aujourd’hui la cause du père Leo Bang Yu-ryong, véritable héritier et artisan d’une vie consacrée authentiquement coréenne.Il sera déclaré « Serviteur de Dieu », première étape vers une éventuelle béatification. Son procès s’ajoute à d’autres causes suivies par l’archidiocèse de Séoul, notamment celles de Monseigneur Barthelemy Bruguière, missionnaire des Missions Étrangères de Paris et premier vicaire apostolique de Corée, ainsi que celle du cardinal Stephen Kim Sou-hwan, premier cardinal coréen de souche.Cette reconnaissance par Rome témoigne de la vitalité de l’Église en Corée, qui continue de s’appuyer sur l’héritage spirituel des martyrs et des grands témoins de la foi.