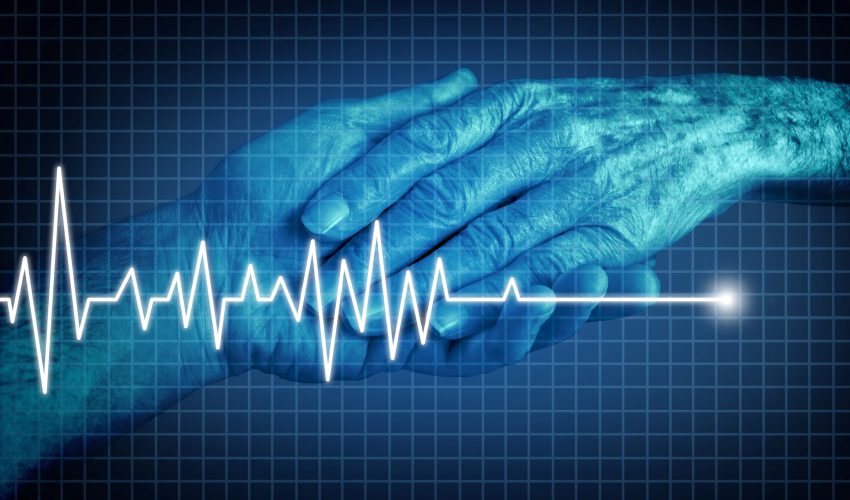Les Slovènes ont rejeté dimanche, à 53 %, la loi légalisant l’aide au suicide, suspendant au moins pour un an un texte qui aurait ouvert la voie à une pratique profondément controversée. En France, où la réforme de la fin de vie avance rapidement, certains pourraient se demander si l’opinion publique ne percevrait pas, elle aussi, qu’il existe des frontières éthiques que le progrès technique ou la pression sociétale ne doivent pas abolir.Le vote slovène marque un tournant inattendu. Adoptée une première fois par référendum en 2024, confirmée par le Parlement en juillet 2025, la loi sur l’aide à mourir semblait acquise, mais une mobilisation citoyenne, soutenue par l’Église catholique et l’opposition conservatrice, a obtenu 46 000 signatures, dépassant le seuil légal et provoquant un nouveau scrutin. Le résultat est clair, 53 % de « non », 47 % de « oui », avec une participation de 40,9 %, juste suffisante pour que le rejet soit juridiquement valide.
Cette décision reporte l’application de la loi d’au moins douze mois puisque le Parlement slovène ne pourra pas revenir sur le sujet avant un an. Beaucoup y voient un signal politique fort dans un pays marqué par une tradition chrétienne vivante et une sensibilité aiguë aux questions éthiques et anthropologiques
Les opposants se réjouissent. Aleš Primc, figure de proue du camp du non, a déclaré que « solidarité et justice » avaient remporté une victoire, accusant le gouvernement de vouloir fonder des réformes sociales sur la mort et l’empoisonnement. Le Premier ministre Robert Golob, partisan de la loi, avait pourtant appelé à la soutenir pour que « chacun de nous puisse décider avec quelle dignité il terminera sa vie ». La fracture demeure profonde.Au cœur du débat, se trouve une interrogation fondamentale, que signifient la dignité, la souffrance, la liberté, la vulnérabilité. Plusieurs pays européens comme l’Autriche, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse autorisent déjà l’aide active à mourir, d’autres la condamnent strictement. La Slovénie, qui s’orientait vers une législation libérale, choisit pour l’heure d’interrompre sa marche.
L’Église catholique slovène a joué un rôle important dans cette prise de conscience. Elle a rappelé que l’assistance au suicide contredit l’Évangile, la loi naturelle et la dignité inhérente à toute personne humaine.
Lire aussi
Ses responsables parlent d’un devoir de protection envers les plus fragiles, personnes âgées, malades, isolées, handicapées, souvent les premières à se sentir de trop dans une société utilitariste. D’autres voix, non religieuses, ont souligné le risque d’une banalisation d’une « culture de la mort », où l’autonomie individuelle serait invoquée pour masquer un abandon collectif.Ce référendum révèle aussi des blessures sociales profondes. Beaucoup de Slovènes ont voté non parce qu’ils estiment que le pays manque de soins palliatifs, de soutien familial et de solidarité, et que l’euthanasie ou le suicide assisté risqueraient de devenir une fausse solution, proposée faute de mieux. Les électeurs favorables à la loi invoquent quant à eux l’expérience de la souffrance extrême, le besoin de libre choix, l’idée de dignité personnelle. Le pays reste partagé entre deux conceptions de l’humanité.
En France, le débat sur la fin de vie reste enlisé, les textes sur les soins palliatifs et l’aide à mourir ayant été reportés à cause de la crise politique et des changements de gouvernement. Le Sénat n’a toujours pas fixé de date d’examen, malgré l’insistance du gouvernement pour trancher avant 2027. Dans ce climat d’incertitude, certains appellent désormais à un référendum, comme en Slovénie. Peut-être l’opinion française saisirait-elle, comme les Slovènes, qu’une société ne se juge pas seulement à la liberté qu’elle proclame, mais aussi à la manière dont elle entoure, soutient et accompagne ceux qui souffrent.
Ce qui est certain, c’est que le vote slovène rappelle que lorsqu’il s’agit de vie, de souffrance et de mort, les nations cherchent non seulement des lois, mais un accord moral, un repère commun, un cadre de civilisation. En Slovénie, la réponse a été donnée, non au suicide assisté, oui à la vie partagée, même lorsqu’elle est difficile.