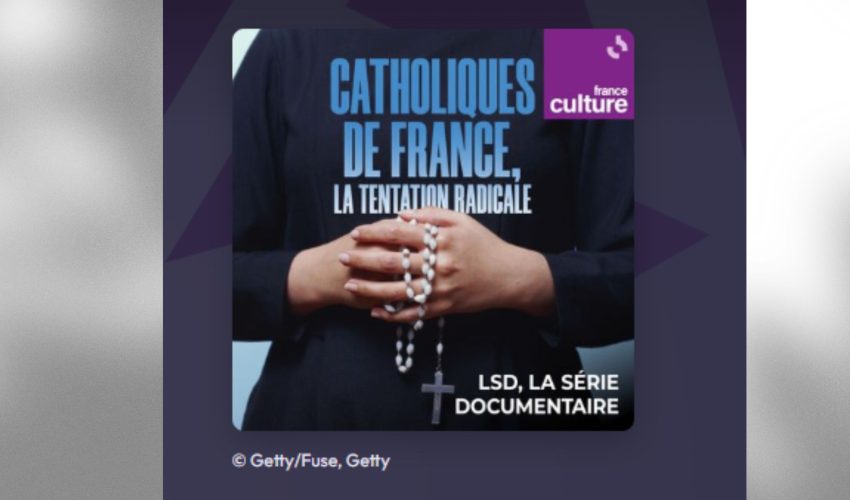Par Philippe Marie
L’image de présentation en dit long. On y voit une personne tenant un chapelet, symbole de prière et de paix, mais ici présenté presque comme un signe de suspicion. Le cadrage serré, l’absence de visage, et le titre « La tentation radicale » donnent à ce simple geste de foi une connotation inquiétante. Comme si, en France aujourd’hui, afficher sa foi catholique devenait un acte à justifier, voire à craindre. Ce choix visuel résume à lui seul le malaise d’un certain regard médiatique qui confond ferveur spirituelle et dérive idéologique.De même à la lecture de la présentation de la série documentaire diffusée sur France Culture, « Catholiques de France, la tentation radicale », qui débute ce lundi 3 novembre, on comprend d’emblée où l’on veut nous emmener. Le titre est déjà un avertissement : la foi vécue avec ferveur devient une « tentation », et la fidélité à la tradition, une dérive.
Derrière le ton d’enquête, l’intention transparaît : il s’agit moins de comprendre le renouveau catholique que de le mettre en examen.
Cette série, signée par Isabelle de Gaulmyn, ancienne rédactrice en chef de La Croix, prétend explorer les “mutations” du catholicisme contemporain. En réalité, elle reflète une inquiétude, et plus encore, un nouveau type de stigmatisation. Pour les tenants d’une inclusion totale, il est pour le moins étrange de voir que l’inclusivité est ici à sens unique : elle s’arrête là où commence la foi vécue pleinement. On prône le dialogue, mais on exclut les croyants qui ne rentrent pas dans les cases du “catholicisme respectable” qu’ils ont eux-mêmes défini , un catholicisme sans aspérité, » all inclusif » et conforme aux valeurs dominantes de ce monde.Depuis quelque temps, l’on sent poindre une méfiance sourde dans certains milieux intellectuels et médiatiques à l’égard d’un catholicisme jugé trop visible, trop fervent, trop engagé. La série documentaire de France Culture s’inscrit pleinement dans cette logique de soupçon. Elle met en scène un catholicisme décrit comme “en recomposition”, où les pèlerinages de Chartres, la Manif pour tous ou les communautés attachées à la liturgie traditionnelle deviennent les symptômes d’un “retour inquiétant à l’identité chrétienne”.
Ce discours d’apparente bienpensance tend à assimiler la ferveur à la menace, la fidélité à la doctrine à la rigidité, la cohérence morale à l’intolérance. Comme si le simple fait de croire, de prier ou de défendre la vie suffisait désormais à mériter une étiquette de dangerosité.
Lire aussi
Le mot “radicalité”, omniprésent dans le documentaire, mérite pourtant d’être pris à la lumière de l’Évangile. Il n’a rien à voir avec une idéologie meurtrière. La radicalité chrétienne, c’est celle du Christ qui appelle à tout donner, à se convertir, à aimer jusqu’à l’ennemi. Le pape François lui-même , dont le pontificat demeure profondément marqué par ce thème, parlait souvent le langage de la radicalité évangélique, non pour exclure, mais pour réveiller les consciences. Il osa, dans une homélie du 14 octobre 2018, jour de la canonisation de Paul VI, de Mgr Romero et d’autres témoins de la foi, rappeler que :
« Jésus est radical. Il donne tout et demande tout. Jésus ne se contente pas d’un pourcentage d’amour : nous ne pouvons pas l’aimer à vingt, à cinquante ou à soixante pour cent. Ou tout ou rien. »
Cette radicalité, chez lui, n’était pas dureté. François liait toujours l’exigence évangélique à la miséricorde. La miséricorde, répétait-il, ne consistait pas à ignorer les préceptes divins, mais à permettre au pécheur de se relever, de retrouver la voie de la perfection évangélique. Il n’hésitait pas à dénoncer le mal sous toutes ses formes, qualifiant par exemple l’avortement de « recours à un tueur à gages » (audience générale du 10 octobre 2018), tout en tendant la main à ceux qui portaient le poids de la faute.Cette radicalité chrétienne, c’est celle du cœur, pas celle de la violence physique.
C’est le refus du compromis moral qui ouvre la porte à toutes les dérives , non l’obsession identitaire , mais rappelons que tout homme porte en lui son identité, ce mot ne doit pas être présenté comme un gros mot.
C’est le courage d’aimer la vérité, même quand elle dérange. C’est cette même radicalité dont parlait déjà Benoît XVI, dans son homélie d’inauguration du pontificat, le 24 avril 2005 : « Être chrétien n’est pas une appartenance superficielle ou culturelle ; c’est un acte radical de confiance et de don, qui engage toute la vie. » Ce mot résume toute la vocation chrétienne : le choix d’un amour total, d’une fidélité sans calcul, d’un engagement qui traverse la vie entière.
Pourtant, dan sa présentation la série de France Culture préfère brouiller les pistes. En juxtaposant piété, militantisme et politique, elle entretient l’idée d’une continuité entre la foi et la révolte, le combat et la haine. Mais c’est ignorer que l’Église a toujours combattu la politisation de la foi. Les dérives idéologiques, qu’elles soient d’extrême droite ou d’extrême gauche, n’ont jamais représenté le christianisme. Les catholiques qui prient à Chartres, qui se confessent, qui enseignent à leurs enfants la foi, ne sont pas des radicaux au sens où l’entend le monde. Ils sont simplement fidèles. Ce que redoute une société postchrétienne, ce n’est pas l’extrémisme religieux : c’est la cohérence spirituelle.Le pape Léon XIV l’a encore rappelé récemment, au cimetière du Campo Verano : « La charité triomphe de la mort. » (Homélie pour la Commémoration de tous les fidèles défunts, 2 novembre 2025). Cette phrase résume tout. La véritable radicalité chrétienne n’est pas de s’opposer par haine, mais de se donner par amour. Elle ne brandit pas un étendard politique, elle porte une croix. Ceux qui veulent réduire la foi à une opinion privée ou à un folklore inoffensif ne supportent pas cette vérité : l’Évangile, lorsqu’il est vécu pleinement, dérange.
La radicalité chrétienne, disait encore le pape François, c’est « ou tout ou rien ». Et c’est précisément ce « tout » que notre époque n’accepte plus. Oui, le Christ est radical, car Il appelle à la conversion intégrale, à l’amour absolu, à la vérité sans détour. Non, cela n’a rien à voir avec les dérives idéologiques ni avec les fanatismes de notre temps. Et si aimer le Christ sans mesure, défendre la vie sans honte, prier sans relâche et témoigner sans peur, c’est être radical — alors, qu’on nous appelle ainsi. Mais qu’on nous appelle par notre vrai nom : chrétiens.