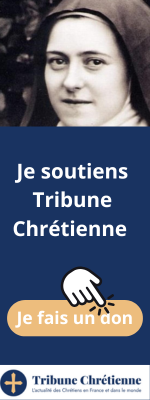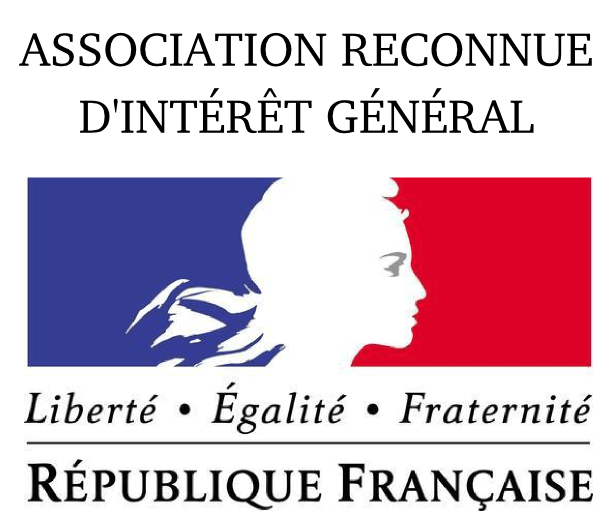Au fil des siècles, le Jardin du Luxembourg a vu défiler de nombreuses époques et a connu diverses transformations qui ont façonné son histoire riche et fascinante.
Remontons le temps jusqu’au IIIe siècle, à l’époque des Gallo-Romains. Les fouilles archéologiques ont révélé des trésors enfouis, attestant de la présence de villas opulentes. Parmi les découvertes, des objets d’une grande finesse, tels qu’un manche de miroir, un bracelet et des boucles d’oreilles, ont émerveillé les archéologues. Une villa, datant probablement de la fin du Ier siècle, ornée de fresques polychromes et d’au moins un bassin en mosaïque, a été mise au jour. Des ateliers de poterie témoignent également de l’existence d’un quartier artisanal, avec des morceaux de poterie sigillée et même un four de potier. Ces découvertes dévoilent un passé riche en créativité et en sophistication.
Au XIe siècle, Paris est sous le règne de Robert II, surnommé Robert le Pieux. C’est à cette époque que le quartier est essentiellement dédié à la culture de la vigne, bien que le vin produit ici soit réputé pour son acidité. Robert le Pieux choisit ce lieu verdoyant pour y établir sa résidence, le Château de Vauvert, l’une des premières résidences royales de Paris.
Cependant, des événements tumultueux entourent ce lieu, notamment le divorce du roi avec son épouse Rosalia et son mariage avec sa cousine Berthe de Bourgogne, ce qui conduit à son excommunication. Après la mort de Robert II en 1031, le château est abandonné et devient un endroit maudit, craint pour la présence du diable.
Le château de Vauvert, après la mort de Robert le Pieux, prend une tournure inquiétante. Situées hors des murs de la ville et à proximité d’une route menant à Orléans, ses ruines deviennent le repaire de brigands et de mendiants. Les carrières abandonnées à proximité offrent des cachettes idéales. Le vignoble du clos Vigneray permet à tous ces marginaux de s’adonner à la boisson bon marché. Les légendes de l’époque font état de cris, de hurlements et de bruits terrifiants, attribuant au lieu une aura maléfique. Les esprits, les monstres et même le diable sont supposément aperçus ici. Ainsi naît l’expression populaire « aller au diable Vauvert. »
La chartreuse de Vauvert
Au XIIIe siècle, le roi Louis IX, connu sous le nom de Saint Louis, souhaite attirer des ordres religieux à Paris. Il invite les chartreux à fonder un monastère à Vauvert. Les moines chartreux répondent à cet appel et s’installent en 1257. Le château et ses environs deviennent un espace de foi et de prière grâce à leur présence. Avec le temps, le monastère s’agrandit grâce à des acquisitions foncières, et le clos des chartreux occupe une grande étendue à la fin du siècle.
Après la mort de Henri IV en 1610, Marie de Médicis, régente du royaume, cherche à construire un palais à son image. Elle acquiert le Petit Luxembourg en 1612, un endroit où elle venait souvent avec ses enfants. Elle décide d’y édifier un palais italien pour se replonger dans l’atmosphère de son pays natal. Le jardin devient un lieu de jeux pour la famille royale.
Le jardin trouve l’origine de son nom dans l’hôtel du duc François de Luxembourg, dit Petit Luxembourg, bâti au XVIe siècle. D’abord loué, ce dernier est acheté, avec ses 8 hectares de terrain.
Le jardin subit des changements au XVIIIe siècle. Des parties du jardin sont vendues pour financer la rénovation du Palais du Luxembourg, donnant naissance à la rue Guynemer. Certaines allées, telles que la « Vallée des Philosophes, » où Rousseau venait méditer, disparaissent.
Les travaux d’Haussmann au XIXe siècle transforment le jardin. Des portions du parc sont sacrifiées pour élargir des rues et le jardin du Luxembourg prend sa forme actuelle.
Source jardin.senat.fr