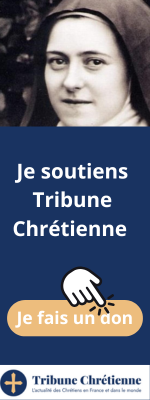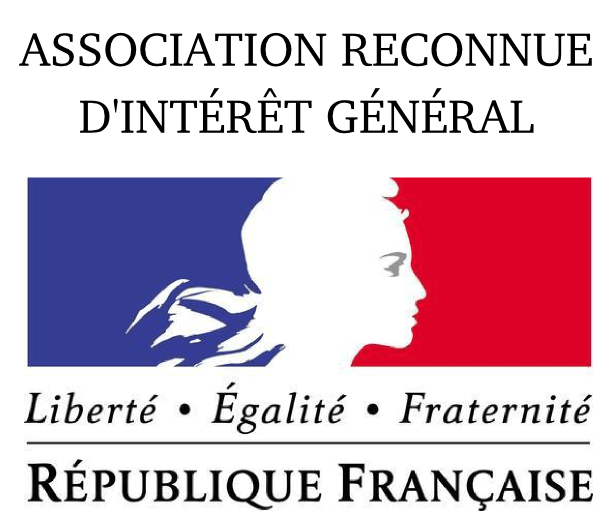Les Foyers de Charité, œuvre spirituelle fondée par Marthe Robin et le Père Georges Finet, sont aujourd’hui dans le viseur d’une commission d’étude pluridisciplinaire, mandatée en janvier 2025 pour enquêter sur d’éventuels abus dans le cadre de leurs activités. Le communiqué officiel, publié le 31 janvier, détaille les objectifs de cette commission, qui entend « rendre compte de manière objective de l’histoire tourmentée des Foyers », « comprendre comment l’Œuvre a pu connaître et, éventuellement, faciliter de telles dérives » et « identifier les leviers à même de supprimer les facteurs qui ont pu les favoriser ».
Ces termes, volontairement larges et ouverts, suscitent déjà plusieurs questions : parle-t-on ici d’une enquête historique impartiale ou d’un examen biaisé qui, sous couvert d’objectivité, cherche à jeter la suspicion sur toute l’institution ? À l’heure où de nombreuses œuvres catholiques sont soumises à des procédures similaires, la prudence s’impose.
Un mandat aux contours préoccupants
L’une des missions affichées de la commission est d’analyser comment les Foyers de Charité auraient pu « faciliter » des abus. Une formulation qui pose problème : pourquoi présumer d’emblée une responsabilité structurelle avant même que les faits ne soient établis ? Si des fautes ont été commises, elles doivent bien sûr être reconnues et corrigées. Mais le risque est grand que cette démarche prenne la forme d’un procès idéologique contre une communauté qui, depuis des décennies, œuvre pour la sanctification des laïcs à travers la prière et la formation spirituelle.
Le communiqué indique que la commission « travaille sur la base d’archives et de témoignages concernant des cas d’abus de toute sorte ou de maltraitance », en France et à l’étranger, depuis la fondation des Foyers en 1936. Il s’agit donc d’un travail colossal, qui s’étale sur près de 90 ans et concerne des contextes culturels et ecclésiaux extrêmement variés. Comment garantir une approche juste et équilibrée sur une période aussi longue ? Comment éviter que des témoignages anonymes et hors contexte ne soient instrumentalisés pour dresser un portrait à charge ?
Lire aussi
Un appel à témoignages à double tranchant
L’appel lancé par la commission s’adresse aussi bien aux victimes qu’aux témoins, et s’élargit à des aspects liés au fonctionnement interne des Foyers : « les conditions de travail des employés et bénévoles », « les relations entre les prêtres et les employés/bénévoles », ou encore « le traitement des cas d’abus exprimés ».
Là encore, on peut s’interroger sur l’intention réelle d’une telle démarche. L’étude annoncée ne se limite pas à des abus caractérisés, mais semble vouloir explorer les relations hiérarchiques et le mode de gouvernance des Foyers. Dans quel but ? Cherche-t-on à comprendre d’éventuels dysfonctionnements ou à déconstruire un modèle de communauté où la place du prêtre et du laïc est clairement définie ? Cette inquiétude est légitime, au regard de la volonté de certains courants de réformer profondément l’Église en remettant en question l’autorité sacerdotale et la structure même des institutions catholiques.
Un travail qui s’annonce long… et risqué
La commission, qui réunit historiens, juristes et théologiens, rendra ses conclusions fin 2026. En deux ans, les Foyers de Charité pourraient ainsi être plongés dans une période d’incertitude et de soupçon, avec le risque d’un préjudice irréparable pour leur réputation, indépendamment des conclusions finales du rapport.
Si l’Église doit faire preuve de transparence et de justice, elle doit aussi veiller à ce que ces enquêtes ne deviennent pas des instruments de déstabilisation pour des communautés qui ont porté – et portent encore – d’innombrables fruits spirituels. L’appel à témoignages est lancé, mais il appartient désormais aux Foyers de Charité et à l’Église de veiller à ce que cette démarche reste un travail de vérité et non une entreprise de démolition d’une œuvre catholique essentielle.
Communiqué officiel