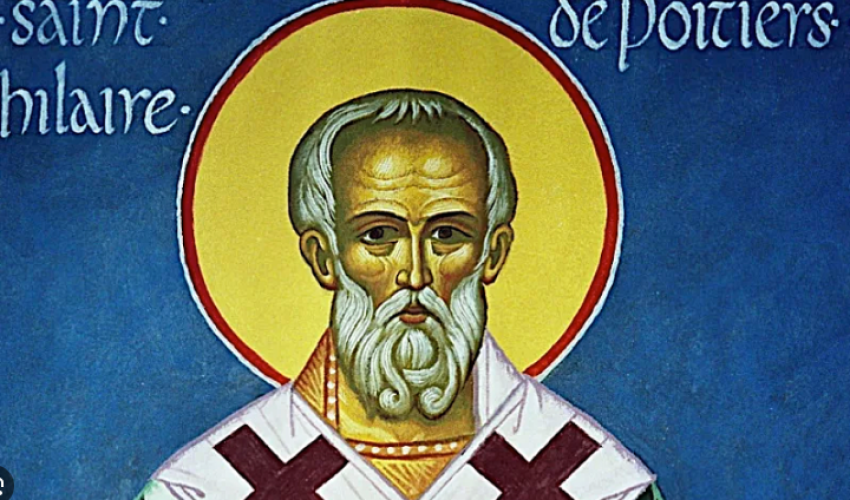évêque de Poitiers, Docteur de l’Église (+ v. 367)
Né dans une illustre et opulente famille païenne d’Aquitaine, ce jeune homme manifesta un talent inné pour les études, mais une question lancinante le tourmentait : Où réside le bonheur pour l’homme ? À quoi cela sert-il d’exister si la mort est inéluctable ? Existe-t-il un dieu ? Ses lectures antérieures l’avaient laissé insatisfait jusqu’au jour où il tomba sur un passage de la Bible qui proclamait « Je suis celui qui est ». Cette découverte l’enthousiasma profondément. Cependant, la perspective de la mort restait insupportable à ses yeux.
Son âme affamée de réponses spirituelles trouva finalement son apaisement dans l’Évangile de saint Jean, qui célèbre l’Incarnation et la Résurrection. À l’âge de trente ans, il décida de demander le baptême, une démarche qui le destina à un avenir remarquable parmi les croyants.
Il fut élu évêque de Poitiers et, au cours de son épiscopat, il fit la connaissance de saint Athanase d’Alexandrie, alors en exil en Gaule en raison de la controverse arienne. À son tour, il s’engagea dans la lutte contre cette hérésie et fut lui-même exilé en Phrygie, une ancienne région d’Asie Mineure, aujourd’hui située en Turquie.
Durant son exil en Phrygie, il plongea dans l’étude de la théologie grecque. À son retour en Gaule, il parvint à promouvoir à la fois l’orthodoxie chrétienne et la paix religieuse. En accueillant saint Martin pour fonder le monastère de Ligugé, situé sur la carte de GoogleMaps, il contribua grandement à l’établissement du monachisme en Gaule. Dans son œuvre majeure, le « Traité sur la Trinité », il fut le premier à introduire en latin les subtilités et les nuances de la langue grecque. Parmi les Pères Latins, il demeure le plus proche des Pères Grecs dans sa pensée théologique.
Saint Hilaire de Poitiers, qui vécut au IVe siècle, devint ainsi le premier évêque de Poitiers dont l’existence est attestée avec certitude, et il se distingua comme l’un des grands théologiens chrétiens de son époque.
Son engagement pour la foi trinitaire le conduisit à l’exil, alors que la Gaule était marquée par l’arianisme. Pendant cette période, il rédigea son ouvrage le plus célèbre, le « De Trinitate », avant de retourner en Orient pour y terminer sa vie, à Poitiers, aux alentours de l’an 367 ou 368.
Lors d’une audience générale en octobre 2007, devant une foule de 23 000 personnes place Saint-Pierre, Benoît XVI évoqua la figure imposante du docteur de l’Église, Hilaire de Poitiers. Ce saint, probablement né païen en 310 au sein d’une famille aristocratique locale, se convertit après une quête acharnée de la vérité. En 353, il fut élu évêque de sa ville natale et s’opposa vigoureusement à l’arianisme, une hérésie qui niait la divinité de Jésus-Christ.
Cette position lui valut d’être exilé en Phrygie sur ordre de l’empereur Constance, qui avait adopté les résolutions du synode de Béziers, majoritairement composé d’ariens. À la mort de l’empereur, Hilaire put regagner Poitiers en 361, où il s’éteignit six ans plus tard.
Son œuvre principale, le « De Trinitate », retrace son parcours personnel vers la connaissance de Dieu et démontre clairement, selon lui, que les Écritures témoignent de la divinité du Fils, de sa similitude avec le Père, tant dans l’Évangile que dans l’Ancien Testament, révélant ainsi le mystère du Christ. Le Saint-Père rappela que ce saint évêque développa sa théologie trinitaire à partir de la formule baptismale même, qui invoque le Père, le Fils et l’Esprit Saint.
Hilaire de Poitiers proposa également des méthodes d’interprétation de l’Évangile. Il souligna que certaines pages des Écritures déclarent que Jésus est Dieu, tandis que d’autres mettent en avant son humanité. Certaines évoquent sa préexistence aux côtés du Père, son incarnation, sa mort et sa résurrection.
Malgré sa ferme opposition à l’arianisme, Hilaire se montra conciliant envers ceux qui acceptaient la similitude essentielle entre le Fils et le Père dans leur nature divine, tout en cherchant à les ramener à la foi véritable, qui insiste non seulement sur la similitude mais aussi sur l’égalité dans la nature divine.
Le Pape conclut en rappelant que Dieu, étant l’amour suprême, a la capacité de communiquer sa pleine divinité au Fils. Par l’incarnation, le Fils s’est uni à toute l’humanité, ouvrant ainsi la voie vers lui pour chaque individu par le biais de la conversion personnelle.
Ce passage se termine par une prière de saint Hilaire, exprimant son désir de conserver sa foi inébranlable jusqu’à la fin de sa vie et de proclamer avec conviction le symbole de sa nouvelle naissance, lorsqu’il fut baptisé au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint, unissant ainsi sa voix à sa foi profonde. (Traité de la Trinité).
Source nominis