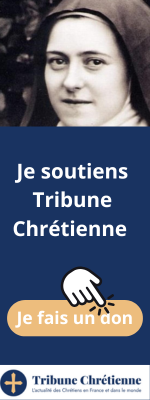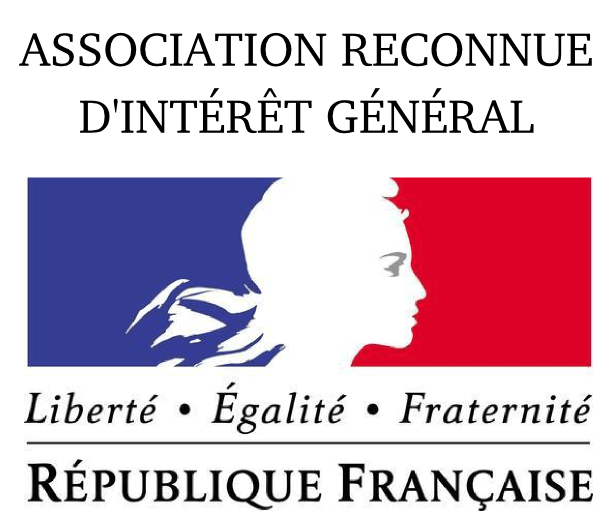Par Stéphane Brosseau*
Les outils de la symbolique des églises
Après avoir vu l’importance des orientations dans notre article précédent, pour comprendre les messages des églises au moins jusqu’au concile de Trente (fin XVIe s.) dans le précédent article, poursuivons sur les outils du langage symbolique à la disposition des bâtisseurs.
Nous avions évoqué les clochers et les flèches, élévations des âmes et jonctions de l’humanité avec son Créateur. Leur position est aussi signifiante. La flèche est souvent sur le transept, lieu de l’Incarnation (Paris, Rouen). Elle peut être entourée de 4 clochers secondaires et représente alors le Christ, encadré des évangélistes (Cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky à Paris, Saint-Nicolas à Nice, Notre-Dame de Tournai). Elles peuvent surmonter l’entrée occidentale et mettre en valeur une façade harmonique, allégorie de la perfection divine, (abbaye aux hommes de Caen, cathédrales de Chartres, de Strasbourg[2]) symbole de l’entrée en gloire des croyants entrant dans la maison divine à l’instar des généraux romain franchissant un arc de triomphe.
Par ailleurs, les nombres sont fondamentaux, car ils prennent souvent sens dans les Textes bibliques, et on en déduit des formes. Les plus importants sont :
1 : l’Unique, Dieu de Père
2 : la dualité, le témoignage, la double nature de Jésus, homme et Dieu
3 : la Trinité (Père, Fils et la circulation d’amour entre eux, le Saint-Esprit) => forme triangle (forme verticales des nefs, symbole de Dieu
4 : la Terre, les 4 fleuves de la Création, les points cardinaux => formes rectangle et surtout carrée (narthex, base des clochers et des tours devenant ensuite octogonaux en s’élevant, les transepts)

5 : la perfection de la Création (la quintessence, les étoiles à 5 branches pointe en haut (déviées, donc en bas, elles représentent Satan – cf. la rosace Nord de Reims)
6 : le chiffre de l’homme, créé le 6e jour. Celui qui n’est pas Dieu (celui qui est parfaitement opposé à Dieu est 666)
7 : Chiffre de Dieu, 4 et 3 (la Trinité sur Terre, l’homme et la femme), les jours de la Création, 70 fois 7 fois (le nombre de pardons nécessaires) (10 est la multiplication)
8 : le jour de la Résurrection, 8 jours après les Rameaux ; lié à la Résurrection, à la vie éternelle => forme octogonale (clochers, transepts en hauteur, dômes)
9 : 3X3 : la perfection de l’Amour
10 : la multiplication (100 et 1000 aussi)
12 : la multitude, l’universalité
40 : l’attente avant une intervention de Dieu
144000 : (12X12X1000) le nombre d’élus à entrer dans le Royaume de Dieu : tous.
Dès lors, tout prend sens : nombre d’arches et de colonnes, de fenêtres etc.

Étudions à présent les végétaux sculptés, en particulier sur les chapiteaux, sur fresques, mosaïques ou vitraux : ils représentent la vie.
Les arbres ont des sens spécifiques :
- Le figuier : la nourriture céleste, la paix et la prospérité, la connaissance et la recherche de Dieu, il annonce la venue du Christ, car il fleurit dès la fin de l’hiver, comme l’amandier. Il représente la Torah, que l’on médite tout le jour, la parole de Dieu. Quand le Christ avait vu Philippe « sous le figuier » lors de son appel, cela signifie qu’il avait vu que Philippe recherchait Dieu, qu’il était prêt à le suivre.
- L’olivier : c’est l’arbre de la vie dans la tradition hébraïque. Les rameaux d’olivier nous rappellent l’entrée triomphale du Christ à Jérusalem., quand les fidèles de Jésus avaient déposé des branches d’olivier, des palmes et leurs vêtements pour lui constituer un tapis en signe de révérence. Comme son huile éclaire (l’huile en lampe), lubrifie (symbolise l’intermédiaire entre Dieu et les hommes), est absorbée (il représente la miséricorde), l’olivier représente la justice du cœur, la lumière, la prospérité et le renouveau.
- Le palmier : se dit « Tamar » en Hébreu : « qui est beau et élancé », mais aussi « qui donne de l’amertume ». Toutes les femmes appelées Tamar dans la Bible ont eu une histoire dramatique, car la justice humaine rendue par la loi laisse un goût amer. Le palmier représente donc la loi, la justice humaine imparfaite, qui est droite sans être souple (ni charitable ou miséricordieuse) qui pique et n’apaise pas vraiment, et qui laisse un goût amer. Jésus a été accueilli à Jérusalem avec un tapis de palmes et de branches d’olivier.
- Le pommier : l’arbre « de la connaissance, symbole du péché originel de l’homme, de la tentation de Adam et Eve, du châtiment infligé ensuite par Dieu. Il s’agit dans la Bible d’un arbre aux fruits savoureux et odorants, qui font envie par leurs couleurs chatoyantes et que l’on croque. Les artistes ont souvent représenté un pommier, mais c’est une extrapolation.
- Le sycomore : dans la Bible, il s’agit non pas d’un érable mais d’un ficus. Il représente la régénération, la réhabilitation, la rupture pour un renouveau, car quand on lui coupe une branche, de nouvelles branches s’y développent. Zachée a grimpé sur un sycomore pour voir Jésus, c’est-à-dire qu’il coupait ses anciennes branches du péché.
Poursuivons avec les feuilles :
- Acanthe : reconnaissable à son feuillage découpé, elle est présente sur les chapiteaux de style corinthien par exemple. Si elle symbolise la douceur, la fécondité, ses épines font que la tradition l’a souvent assimilée au chardon comme symbole de la Passion.
- Arum : il est le symbole de la puissance et de la pureté. Il est le plus souvent représenté par des feuilles élancées, par exemple en chapiteaux.
- Armoise : très ressemblante à la feuille d’acanthe mais sans épines.
- Vigne, grappe de raisins : la vigne est le symbole du Christ et représentation de l’Eucharistie.
- Épis de blé : ils rappellent la nature humaine du christ, Pain de Vie.
- Lierre : élément décoratif très employé en sculpture, il est de longue date un symbole de l’immortalité de l’âme. Les chrétiens l’ont assimilé, au Moyen Âge, à la vie éternelle. Il est aussi signe de fidélité, car les racines du lierre s’accrochent. Ne pas le confondre avec des cordes, symboles de communauté.
- Chardon : symbole de la douleur du Christ et de la Vierge. Il est aussi, comme la châtaigne, l’image de la vertu protégée par ses piquants).
L’étude symbolique des couleurs[3] doit aussi être abordée, tant les édifices étaient colorés.
Elle n’est pas liée au hasard. Les couleurs primaires correspondent aux branches du Tétragramme, et chacune des couleurs a un sens particulier.
Le Jaune, l’or : le soleil, la lumière divine
L’Orange : A mi-chemin entre l’or céleste et le feu de la terre, c’est l’équilibre entre l’esprit et ses passions, la tempérance et la fidélité, de la foi constante en la miséricorde divine.
Le Rouge : l’amour, le sacrifice, la royauté, le feu de la Pentecôte (les portes occidentales doivent être de cette couleur, car nous empruntons alors un chemin de Sacrifice, d’Amour et de Royauté (chaque baptisé étant prêtre, prophète et roi)
Le Violet : l’éternel recommencement, le renouvellement, les sens et l’esprit, la passion et l’intelligence, l’amour et la Sagesse. La pénitence et la préparation
Le Bleu : le ciel, la couleur mariale (les plafonds des temples antiques étaient bleu et or).
Le Vert : l’Espérance, la couleur épiscopale.
Nous avons bien avancé. Il nous restera à étudier certains meubles, objets, ou motifs, ce qui nous permettra, à l’aune des évolutions philosophiques, théologiques et techniques, de comprendre le mouvement d’une église, sa progression.
[1] « Ecoute la Pierre », TheBookedition (par Internet),
« Chartres, quintessence de la symbolique », Edilivre (Internet ou librairie),
« Symbolique de l’église Notre-Dame-de-L’Assomption d’Auvers-sur-Oise », Edilivre (Internet ou librairie),
« Symbolique de l’église de Notre-Dame de Lourdes de La Baule », Edilivre (Internet uniquement)
[2] prévue à deux flèches)
[3] La couleur des ornements et des parements d’autel sert à caractériser le temps liturgique ou la fête célébrée pour les catholiques :
Le blanc: symbolise la Lumière du Paradis. Il est la couleur des fêtes de Notre Seigneur Jésus-Christ, de la Vierge Marie et des Saints non-martyrs.
Le rouge: il est la couleur des Apôtres (sauf Saint Jean l’Evangéliste) et martyrs. Symbolise le Témoignage du sang versé pour le Christ. Il est également la couleur des fêtes du Précieux Sang et de l’Esprit Saint. Il symbolise le feu de l’Esprit (les langues de feu lors de Pentecôte).
Le vert: symbolise l’Espérance. Il est réservé aux dimanches après l’Epiphanie et Pentecôte.
Le drap d’or: peut remplacer ces couleurs.
Le violet: l’Avent, le Carême, les Vigiles et les Quatre Temps.
Le noir: (Qui unit toutes les couleurs) est symbole de survie, d’éternité. On le met le Vendredi Saint et pour les messes des défunts.
Le bleu: symbolise la Vierge Marie.
*Biographie de Stéphane Brosseau

Ancien directeur du sanctuaire de la cathédrale de Chartres, Stéphane BROSSEAU s’attache à montrer la cohérence des bâtiments cultuels, la profondeur et l’intemporalité des messages que les bâtisseurs nous ont transmis dans leur symbolique (orientations, matériaux, formes, couleurs, nombres etc.).
Il est sociétaire de l’Association des Ecrivains Catholiques de Langue Française, auteur de 24 autres ouvrages (encyclopédie sur les 231 cathédrales françaises, essais, poésie, guides d’Histoire de l’art, romans historiques etc.) aux éditions CoolLibri, Nouveaux Mondes, Economica, TheBookedition et Edilivre ; il est aussi conférencier aux journées du patrimoine ou dans des salons littéraires, et formateur en symbologie.
Saint-Cyrien de formation, historien, musicien, breveté de l’Ecole de guerre, il a présidé, dans le cadre des fonctions qu’il occupait jusqu’à l’été 2018, la commission scientifique d’historiens et musicologues, chargée du recensement des œuvres de musique militaire.
Il intervient sur les médias (Cnews « En quête d’esprit » sur ND de Paris et Chartres, L’Homme Nouveau, France-Catholique, Radio Espérance, L’Écho Républicain, prononce de nombreuses conférences, fréquente les salons littéraires.