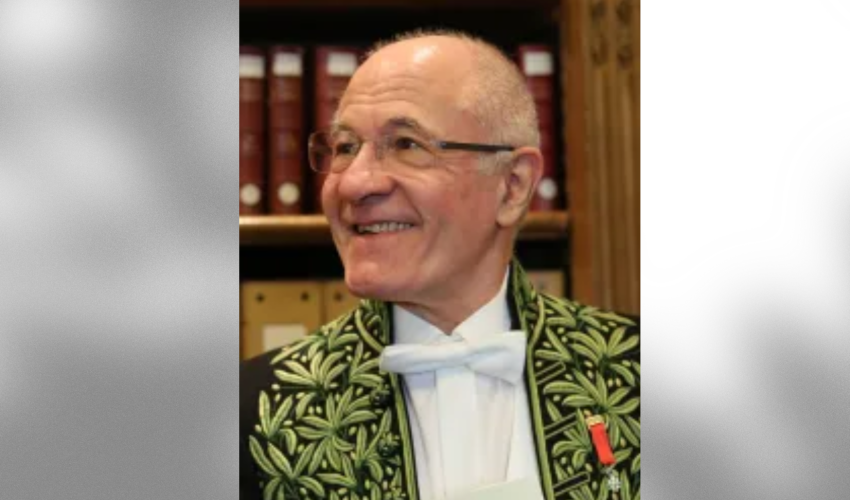Alors que l’Europe vacille entre doute culturel et amnésie historique, La Profondeur du présent (éditions Hermann) de Rémi Brague ( membre de l’institut) analyse les ressorts d’une crise de conscience et d’identité qui traverse notre continent. L’ouvrage invite à relire nos sources grecques, romaines et chrétiennes pour comprendre ce que nous sommes devenus et ce que nous pourrions redevenir. Le livre est un entretien (avec Charles‑Henri d’Andigné) qui propose un panorama de la pensée occidentale, vu à travers le regard érudit de l’auteur.
Rémi Brague est l’un des philosophes français les plus reconnus dans l’histoire de la pensée européenne. Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de philosophie, professeur émérite de l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne et spécialiste du monde grec, juif et arabe médiéval, il a également occupé la chaire Romano Guardini à l’université de Munich. Élu en 2009 à l’Académie des sciences morales et politiques, l’une des cinq académies de l’Institut de France, il en a assumé la présidence en 2022-2023. Lauréat du Grand Prix de philosophie de l’Académie française et du Prix Ratzinger, il poursuit aujourd’hui une œuvre qui interroge la mémoire longue de notre civilisation.C’est dans cet esprit que nous avons rencontré l’un des penseurs qui connaît le mieux les fondations intellectuelles de l’Occident.
Tribune Chrétienne : Dans votre parcours intellectuel, vous montrez que l’Europe doit beaucoup à l’héritage grec et chrétien. Pensez-vous que notre continent a encore conscience de cette dette, et comment expliquer que tant d’élites occidentales semblent vouloir s’en affranchir ?
Rémi Brague : Non, bien sûr. L’enseignement des langues anciennes a été sabordé à partir des années 60, qui sont d’ailleurs une ligne de partage des eaux pour tout l’Occident. De son côté, le christianisme recule, en Europe en tout cas. Nous sommes assis sur des trésors que nous ne songeons pas à ouvrir. L’oubli de ces héritages a plusieurs raisons. Déjà, le simple fait que ce que nous avons reçu soit perçu comme une « dette ». On peut se demander à qui au juste nous pourrions la rembourser. En revanche, nous ne sommes pas obligés de nous montrer ingrats envers tout ce qui nous a précédés : nos ancêtres, mais aussi tout le processus de l’Évolution, big bang compris. D’une manière générale, ne pas s’être créé soi-même devient pour beaucoup de nos contemporains quelque chose d’insupportable. Comprendre que le Créateur est bienveillant serait un premier pas vers la récupération de l’héritage qui nous a faits ce que nous sommes.
Tribune Chrétienne : Vous analysez avec précision la modernité, les Lumières et l’individualisme. Selon vous, quels sont les points où la modernité a rompu avec l’anthropologie chrétienne au point de fragiliser la cohésion morale et culturelle de nos sociétés ?
Rémi Brague : Merci du compliment. Plus sérieusement, maintenant : la modernité n’a pas largué les amarres uniquement avec la conception chrétienne de l’homme. C’est toute l’anthropologie prémoderne qui est passée à la trappe. Péguy l’a très bien vu : le monde moderne est un parasite qui se nourrit des mondes qui le précèdent et qu’il ne cesse de nier. Pour la vision prémoderne des choses, l’homme était, pour les Païens, le chef d’œuvre de la Nature, et pour les religions bibliques, la créature d’un Dieu bienveillant qui l’a fait à son image. Dans les deux cas, il possède une dignité qu’il ne peut jamais perdre, et il est soumis à des devoirs auxquels il ne peut se soustraire sans perdre de ce qui le rend véritablement humain.
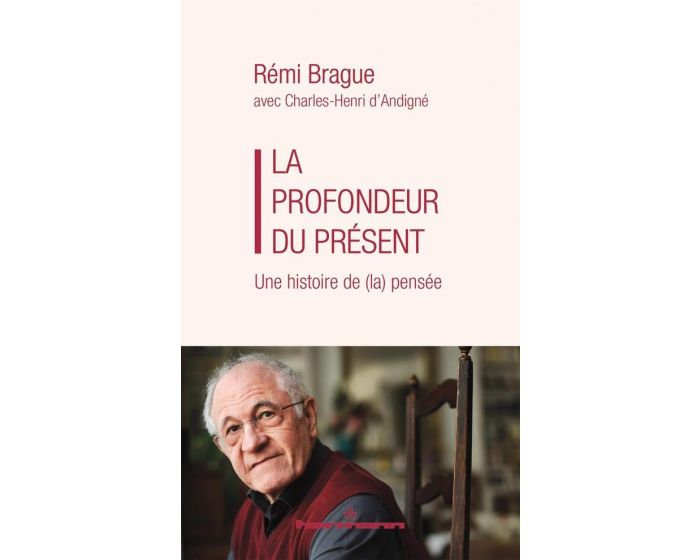
Tribune Chrétienne : Votre réflexion sur l’islam distingue toujours religion et civilisation. Dans le débat public actuel, marqué par des crispations et des simplifications, comment appeler à la lucidité sans tomber dans l’idéologie ni dans l’angélisme ?
Rémi Brague : Il faut en effet distinguer avec soin les deux, ne pas mettre au crédit ou au débit de l’une ce qui relève de l’autre. L’ennui étant que, pour beaucoup de Musulmans, les deux ne se distinguent pas radicalement. Ce qui a des causes historiques : au Moyen Age, les pays d’Islam, qui avaient ramassé le jackpot du savoir grec, et qui avaient su le prolonger, étaient en avance sur Constantinople et sur l’Europe. Cela servait aussi d’argument en faveur de la religion de Mahomet, censée être la dernière, la religion définitive destinée à remplacer judaïsme et christianisme. Ensuite, les deux, religion et civilisation, cessèrent d’être en phase, en gros à partir de la Renaissance, avec des prodromes dès le XIe siècle. Il y a beau temps que la prétention d’avoir la vérité en religion jure avec l’arriération culturelle des pays d’islam. Il y a aussi une cause interne, et c’est que l’islam est certes une religion, mais tout aussi décidément un système de règles de vie (une « Loi », si l’on veut…) qui vous dit ce qu’il faut faire pour être dans les clous par rapport à Dieu : quoi manger et ne pas manger (du porc), quoi boire et ne pas boire (de l’alcool), comment s’habiller (un voile pour les dames), comment se coiffer (de la barbe et peu de moustache — pour les messieurs, s’entend…), etc., bref, tout ce qui définit une civilisation.
Tribune Chrétienne : Vous évoquez la démocratie, en soulignant la différence entre la conception grecque et la conception moderne. Dans un contexte où les institutions occidentales vacillent, quel modèle vous semble le plus apte à préserver la liberté réelle de la personne humaine ?
Rémi Brague : Dans un texte devenu classique, Benjamin Constant a opposé la liberté antique et la liberté moderne. La première consiste en gros à avoir le droit de participer à la vie publique ; la seconde à avoir celui de mener une vie privée, sans que les institutions de la cité y interfèrent. Mais, dans la cité grecque, seule une minorité jouissait de ce droit. Nos sociétés doivent généraliser la liberté grecque. Ce qui ne peut se faire sans l’idée biblique de l’égale dignité de toutes les personnes.
Tribune Chrétienne : Vous abordez longuement la postmodernité et ce qu’on appelle le « wokisme ». À vos yeux, s’agit-il d’une simple mode culturelle ou d’un phénomène plus profond, susceptible d’entraîner une rupture durable avec les fondements de la civilisation européenne ?
Rémi Brague : A vrai dire, j’utilise fort peu ces termes. Ils désignent des phénomènes contemporains, qui sont en effet à la mode dans certains milieux intellectuels. Mais en dernière analyse on peut y voir la forme extrême, voire pathologique, de tendances plus anciennes, l’écume d’une vague qui se gonfle depuis des siècles. L’idée de recommencer à zéro, de faire table rase, est déjà dans la première moitié du XVIIe siècle, chez Descartes. Au siècle suivant, ce qui n’était chez lui qu’une « élection » à la saint Ignace, à l’usage du seul individu, a été transposé au niveau collectif chez les auteurs des « Lumières », pour devenir la critique des « préjugés ». Chez eux, il s’agissait de décaper les institutions pour retourner à la Nature et lui redonner tout son lustre. Mais nous nous sommes débarrassés de l’idée selon laquelle il y a du naturel en nous, et même dans les réalités extérieures : une Loi naturelle à respecter et des lois de la Nature dont il faut tenir compte. Or, certains les nient : un homme peut être enceint, le sexe (et pas seulement le « genre ») est une construction sociale, etc. Mais, « chassez le naturel, etc. » Nier la Nature mène à la mort, sans phrase. Donc, le mouvement s’autodétruira.
Tribune Chrétienne : Vous concluez de manière inattendue avec Tintin, un héros souvent critiqué aujourd’hui au nom de lectures anachroniques. Que dit l’univers d’Hergé sur la vision du monde que la culture européenne portait encore il y a quelques décennies, et que nous peinons désormais à transmettre ?
Rémi Brague : Ce n’est pas moi qui ai choisi de choisir mon goût immodéré pour Tintin. Les procès qu’on lui fait sont orientés : se moquer du paternalisme colonial de Tintin au Congo (1931) est un peu facile. Mais personne ne songe à lui reprocher l’antiaméricanisme rabique de Tintin en Amérique (1932), ou sa critique, d’ailleurs tout à fait justifiée, de l’impérialisme japonais dans Le Lotus bleu (1935) ou des marchands de canons dans L’Oreille cassée (1937), ou encore sa dénonciation de « Müsstler » dans Le Sceptre d’Ottokar (1939). Les albums de la grande époque, de L’Affaire Tournesol (1956) jusqu’à Vol 714 pour Sidney (1967) nous proposent des héros qui ont leurs faiblesses, et même leurs ridicules, mais pour lesquels il existe un bien qu’il faut choisir et défendre et un mal dont il faut se garder.