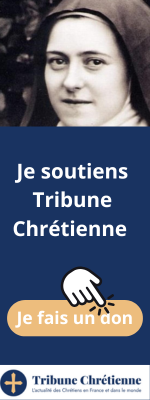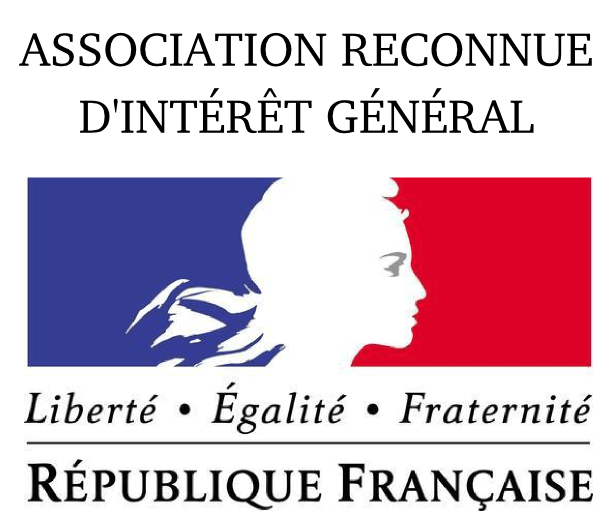L’histoire de l’Église catholique à Cuba est riche et complexe, façonnée par des siècles de colonisation espagnole, de révoltes et de changements politiques. Depuis l’arrivée des premiers missionnaires catholiques au début du XVIᵉ siècle, l’Église a joué un rôle central dans la vie sociale, culturelle et éducative de l’île. Les premiers missionnaires à arriver à Cuba étaient des prêtres franciscains et dominicains. Ils ont débarqué sur l’île en 1511, peu après la découverte de Cuba par Christophe Colomb en 1492.
Les missionnaires franciscains ont établi plusieurs premières missions à Cuba, jouant un rôle majeur dans l’introduction du christianisme sur l’île. Ces premiers efforts ont principalement consisté en la construction de chapelles et la conversion des populations indigènes, bien que cette mission ait été compliquée par la résistance des Taïnos (les premiers habitants de Cuba) et les conditions difficiles de l’île.
Fray Diego de la Vega, est souvent cité comme l’un des premiers à avoir créé une mission permanente sur l’île en 1514, marquant le début de l’évangélisation de Cuba. En tant que colonie espagnole, l’ile est devenue un bastion du catholicisme en Amérique latine, avec des prêtres et des évêques influents qui ont largement contribué à l’éducation et à la structuration de la société.
L’Église à Cuba s’est progressivement installée comme une force majeure, construisant des écoles, des hôpitaux et des œuvres charitables, et jouissant d’une grande influence sur la vie publique. Cependant, au cours du XIXᵉ siècle, une série de révoltes contre l’autorité coloniale espagnole ont conduit à un renouveau de l’identité cubaine.
Après la guerre d’indépendance de 1898, Cuba a été confrontée à un dilemme de pouvoir entre la domination américaine et les aspirations nationalistes locales. L’Église a soutenu les efforts d’indépendance, mais elle a aussi été critiquée par certains groupes progressistes pour sa proximité avec les autorités coloniales.

Au XXᵉ siècle, et particulièrement après la révolution de 1959 menée par Fidel Castro, l’Église à Cuba a vu sa position transformée radicalement. En effet, la prise du pouvoir par Castro a signifié un tournant brutal pour les relations entre l’État cubain et l’Église catholique. La Révolution, soutenue par une idéologie marxiste-léniniste, a entraîné la suppression systématique de toute forme de croyance religieuse au nom de la construction d’une société socialiste athée.

L’Église aujourd’hui à Cuba
Aujourd’hui, l’Église catholique à Cuba est dirigée par le Cardinal Juan de la Caridad García Rodríguez, archevêque de La Havane. Né le 11 juillet 1948 à Camagüey, il a été nommé archevêque de La Havane le 26 avril 2016 et créé cardinal lors du consistoire du 5 octobre 2019.
Le Vatican a maintenu des relations diplomatiques avec Cuba, cherchant à promouvoir le dialogue et la compréhension mutuelle. Des visites papales, notamment celle du Pape François en 2015, ont cherché à renforcer les liens entre l’Église catholique et le peuple cubain.
Parmi les principales églises de Cuba, on trouve la Cathédrale de La Havane, située dans la Vieille Havane, cette cathédrale est un exemple remarquable de l’architecture coloniale espagnole mais également la Basilique de la Vierge de la Charité du Cobre, située près de Santiago de Cuba, elle est dédiée à la Sainte patronne de l’île et est un lieu de pèlerinage important. Enfin, l’église du Sacré-Cœur de Jésus, située à La Havane, elle est connue pour ses vitraux majestueux et son architecture néogothique.

Persécutions et discrimination religieuse
La répression religieuse sous le régime de Castro s’est intensifiée dans les années suivant la révolution de 1959. Les chrétiens ont fait face à des restrictions sévères qui ont affecté leur vie quotidienne, leur capacité à pratiquer leur foi et leur liberté d’expression. Cette répression incessante fait de Cuba un lieu où la tentation de l’idéologie marxiste s’oppose violemment à la liberté de croire.
Plusieurs prêtres et religieux ont été emprisonnés ou envoyés en exil pour avoir osé dénoncer la politique du régime ou pour avoir critiqué les violations des droits de l’homme. L’un des exemples les plus emblématiques est celui du Père Félix Varela, un prêtre cubain, qui, bien que décédé au XIXᵉ siècle, est devenu un symbole de résistance face aux tentatives d’élimination de la foi chrétienne sous le régime.
Dans les années récentes, l’Église a continué de subir des pressions, notamment avec l’expulsion de certains prêtres étrangers, accusés d’être « subversifs » ou « porte-parole d’opinions contre-révolutionnaires ».En 2019, un prêtre de La Havane, le père José Conrado, a été accusé de « manipulation idéologique » pour ses critiques publiques du gouvernement. Il a été soumis à des intimidations, sa liberté de mouvement restreinte, et son accès aux médias fut limité.
Ce type de répression est systématique et démontre clairement la volonté du régime de maintenir une emprise totale sur la vie spirituelle du peuple cubain.

Le régime a continuellement restreint les rassemblements publics de chrétiens. Par exemple, les célébrations de Noël étaient interdites dans les années 1960 et 1970, et la construction de nouveaux lieux de culte était pratiquement impossible. De nombreuses églises ont été fermées ou transformées en entrepôts ou en lieux publics non religieux. Ceux qui tentaient d’organiser des rassemblements religieux dans leurs maisons étaient souvent arrêtés, et les groupes de prière clandestins ont été réprimés.
L’enseignement religieux dans les écoles est quasi inexistant. Les enfants sont éduqués dans un cadre laïque et athée, où la religion est souvent reléguée à une simple notion historique, sans place dans les pratiques ou les valeurs de la société cubaine. Les parents qui souhaitent élever leurs enfants dans la foi chrétienne se retrouvent souvent confrontés à des obstacles, et certains prêtres sont accusés d’inciter à la désobéissance en instruisant les jeunes sur des principes de foi.
Dans une lettre ouverte datée du 20 novembre 2024, 63 représentants religieux cubains, réunis au sein de l’Alliance des Chrétiens de Cuba (ACC), ont exprimé leur profond mécontentement face à la situation actuelle. « Nous constatons que l’État cubain refuse l’accès à des droits aussi fondamentaux que celui de se regrouper dans des associations », déplorent-ils, dénonçant notamment la pratique du gouvernement consistant à rançonner les cultes sous divers prétextes.
Dans leur lettre, les dirigeants religieux détaillent une série de 69 cas d’amendes injustifiées imposées à des groupes religieux. Un exemple frappant concerne un chef de communauté religieuse, condamné à verser 20 000 pesos cubains pour n’avoir pas pu prouver la propriété de l’un de ses lieux de culte.
Bien qu’il ait présenté tous les documents administratifs nécessaires pour prouver qu’il était le propriétaire légitime, la procédure n’a pas été annulée et la communauté a perdu le droit de se réunir sur ses lieux de culte. Ce type de tracasseries administratives se répand à travers le pays, le gouvernement utilisant des prétextes comme « rénovation non autorisée » ou « rassemblement interdit », qu’ils soient fondés ou non, pour réprimer les activités religieuses.
Un prêtre anonyme décrit un pays où des personnes âgées pauvres, vivent sans ressources, souvent sans l’aide de la famille. Devant les magasins, de longues files d’attentes se forment. Mais à ses yeux la pire forme de pauvreté dont souffrent les Cubains demeure le manque de liberté. « Maintenant, si vous postez ne serait-ce qu’une photo, ou quoi que ce soit contre le communisme, sur les réseaux sociaux, ils viendront vous chercher. Toute personne qui parle de sa vie quotidienne, de sa précarité ou de ce qui se passe dans l’école de ses enfants, est menacée», prévient-il.
L’idéologie marxiste qui s’est imposée dans le pays depuis 1965 a détruit la société. Elle a ciblé en particulier la famille traditionnelle, favorisant la dispersion des individus. « Ici, il y a des géniteurs, mais il n’y a presque pas de père», constate ce prêtre.( source 1000RDC )

La répression des laïcs
En plus des persécutions ciblant les prêtres, les les laïcs sont également soumis à de fortes pressions. Des groupes de prière et des rassemblements de jeunes chrétiens ont été régulièrement interrompus, et certains laïcs ont été empêchés de quitter le pays sous prétexte de « menaces à la sécurité nationale ». En 2015, plusieurs familles chrétiennes ont été contraintes de déménager après que leurs maisons aient été utilisées pour des prières de groupe, et des pasteurs protestants ont vu leurs lieux de culte fermés sans justification.
Le gouvernement cubain exerce donc une surveillance étroite sur toutes les formes de religiosité, y compris dans les églises. Même si certains espaces de culte sont autorisés à fonctionner, ils sont souvent soumis à des règles strictes et à une surveillance constante. La moindre forme d’opposition à l’idéologie marxiste est immédiatement sanctionnée. Des réunions de prière ou de formation chrétienne sont interrompues, et les participants sont souvent interrogés par les autorités. Cette surveillance vise à prévenir toute forme d’opposition politique, que ce soit de la part des leaders religieux ou des laïcs chrétiens.
Les autorités cubaines continuent de mettre en place des restrictions dans la construction d’églises et dans l’organisation des activités religieuses. Par exemple, l’extension des lieux de culte est systématiquement refusée sous prétexte qu’il n’y a pas de besoin réel, tandis que les autorités attribuent les espaces publics à des fins autres que religieuses. Les chrétiens qui essaient de défendre leur droit à la liberté religieuse se voient souvent répondre par la répression directe.
L’espoir d’une résurrection spirituelle : les chrétiens en résistance
Malgré ces persécutions, la foi chrétienne à Cuba reste un témoignage d’espoir. Les chrétiens cubains continuent de résister dans un environnement hostile, en se soutenant mutuellement dans la prière clandestine, en utilisant des espaces privés pour leurs cultes et en maintenant la transmission de leur foi. La communauté catholique à Cuba, bien que réduite, demeure un phare de lumière dans un contexte d’oppression.Les efforts du Vatican et les visites papales, notamment celle du Pape François en 2015, ont apporté un soutien moral aux chrétiens cubains, mais la situation reste difficile. Les pressions sur les chrétiens n’ont pas disparu, et la lutte pour la liberté religieuse continue d’être un défi majeur.
On constate que bien que la situation ait évolué, les chrétiens à Cuba continuent de souffrir d’une répression systématique qui les prive de leur liberté de pratiquer leur foi. L’athéisme d’État et l’idéologie marxiste restent des piliers fondamentaux du régime cubain, entravant la liberté religieuse et persécutant ceux qui osent s’opposer à la ligne officielle.
Les chrétiens cubains, cependant, n’ont pas renoncé à leur foi et continuent de vivre leur mission, parfois dans l’ombre, mais toujours avec l’espoir d’un avenir où la liberté religieuse sera pleinement respectée. La communauté chrétienne mondiale doit continuer à soutenir ces courageux témoins de la foi, en appelant à une véritable liberté religieuse à Cuba et en soutenant leurs efforts pour résister à cette répression injuste.