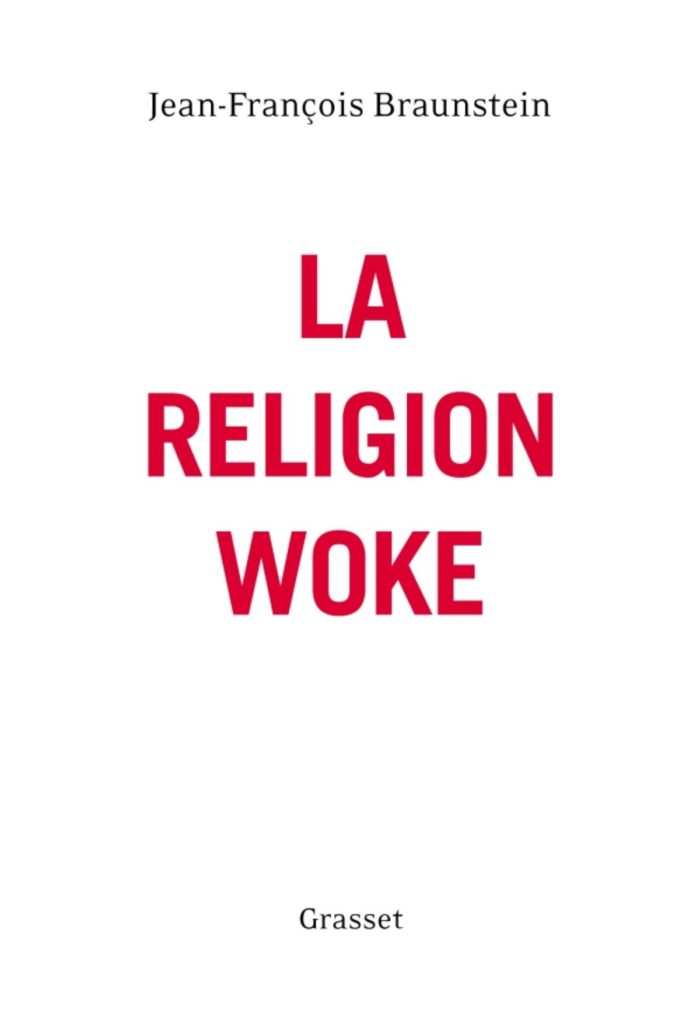Le mouvement woke, qui prône l’égalité et la bienveillance, est comparé à une religion dans l’ouvrage de Jean-François Braunstein, La religion woke. Selon lui, le wokisme se caractérise par des rites, des textes sacrés, du blasphème et des anathèmes, et s’apparente davantage à une Inquisition qu’à une idéologie.
Braunstein analyse les conditions de l’apparition du wokisme et sa transformation en culte post-moderne, et souligne que celui-ci s’est doté de textes fondateurs et d’apôtres qui transmettent ses idées inviolables. Il critique également la manière dont le wokisme traite ceux qui ne partagent pas ses thèses, en les accusant de transphobie, de fascisme, de grossophobie, de validisme, de lesbophobie, d’homophobie, de négrophobie, d’islamophobie, etc. Il met en lumière la condamnation de la « masculinité toxique » et de la « privilege blanc » comme péchés originels, et suggère que le wokisme a pour objectif de déconstruire la société occidentale et de la remplacer par une utopie inatteignable.
Selon Jean-François Braunstein, philosophe et professeur émérite de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le mouvement woke serait en réalité une religion qui se fonde sur des dogmes tels que les hommes peuvent être enceints et les femmes dotées de pénis pour ne pas offenser les personnes transgenres. Les universitaires, affranchis de toute forme de raison ou de remise en question, adoptent ces concepts par paresse intellectuelle. Le wokisme, en s’opposant à l’universalisme, perpétue l’idée de races et rejette l’égalité entre les individus, héritée de la pensée des Lumières, considérée comme raciste.
En se radicalisant et en se construisant comme un extrémisme religieux, le wokisme menace notre modèle républicain hérité des Lumières et aspire à une société bienveillante et égalitaire. Braunstein appelle à réagir face à cette menace.