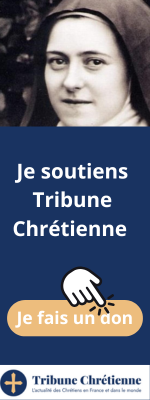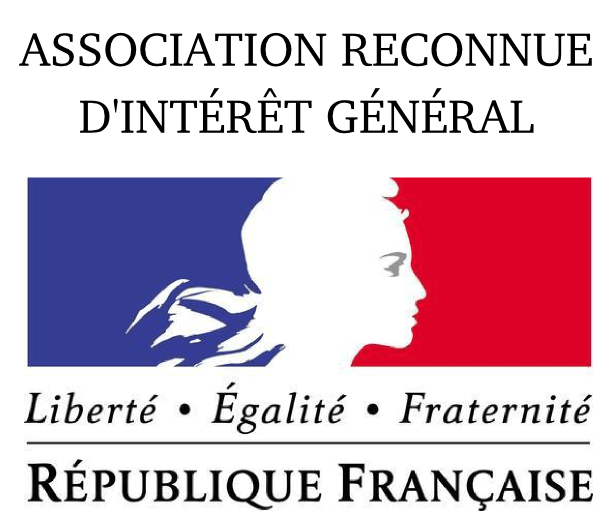La récente décision de la Cour de cassation française, reconnaissant la filiation établie par une décision de justice étrangère dans le cadre d’une gestation pour autrui (GPA) réalisée au Canada, soulève des questions fondamentales sur le respect des principes de droit français.
En effet, lorsqu’un enfant né d’une GPA à l’étranger n’a aucun lien biologique avec le parent d’intention, la filiation établie légalement dans le pays d’origine peut être reconnue par la France. Cette décision met en lumière un flou juridique inquiétant qui pourrait bien permettre de légitimer des pratiques proches du commerce d’enfants.
Une filiation sans lien biologique : un précédent inquiétant
La situation qui a mené à la décision de la Cour de cassation concerne une femme qui s’est rendue au Canada pour recourir seule à une GPA. Aucun lien biologique n’existe entre elle et l’enfant, né d’un don de gamètes et porté par une mère porteuse. Le droit canadien a reconnu cette femme comme la mère légale de l’enfant, une décision qui, bien que conforme à la législation canadienne, a été transférée sur les registres d’état civil français par la cour d’appel, sous la forme d’une adoption.
Cette situation a suscité un recours du procureur général, qui estime que la reconnaissance de cette filiation en France contrevient à l’ordre public international, dans la mesure où elle établit un lien de filiation entre une femme et un enfant qu’elle ne porte pas biologiquement, ce qui pourrait être perçu comme une forme de marchandisation de l’enfant.
Le contrôle de l’ordre public : des garanties insuffisantes ?
Selon la Cour de cassation, l’ordre public international français ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une filiation établie à l’étranger, même lorsque le parent d’intention ne partage aucun lien biologique avec l’enfant. Ce principe repose sur l’idée que la France, en accord avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, admet la possibilité de reconnaître des filiations non biologiques, comme celles établies par l’assistance médicale à la procréation avec un tiers donneur ou la reconnaissance d’un enfant sans lien biologique direct.
Toutefois, cela ne signifie pas que le juge français soit exempt de contrôle. Il doit vérifier l’absence de fraude et la validité du consentement des parties à la convention de GPA. Ce contrôle, bien que présent, reste limité et soulève des interrogations sur la capacité du système judiciaire à véritablement protéger les principes fondamentaux du droit français.
Un nouveau modèle de filiation ?
La Cour de cassation a également fait une distinction importante : la filiation issue de la GPA ne doit pas être assimilée à une adoption, comme l’avait fait la cour d’appel. En effet, la filiation fondée sur la GPA repose sur une logique différente de celle de l’adoption, et c’est cette spécificité qu’il convient de reconnaître dans le cadre de la loi française.
Ainsi, la cour censure la décision de la cour d’appel uniquement sur le point de l’adoption, mais elle maintient la reconnaissance de la filiation en tant que filiation d’intention. Cette distinction pourrait ouvrir la voie à une nouvelle forme de reconnaissance légale des enfants nés de GPA, qui pose la question de savoir si la France est prête à accepter, sous couvert de reconnaissance de droits, un système qui pourrait se rapprocher du commerce des enfants.
Lire aussi
Un signal inquiétant pour la protection de la famille
L’acceptation par la France de ces filiations sans lien biologique, validées par des décisions étrangères, soulève des questions sur l’avenir de la protection des enfants et des familles. Alors que la GPA reste interdite en France, les pratiques juridiques internationales semblent peu à peu imposer une réalité où les droits des enfants sont subordonnés aux intérêts des adultes.
Cette reconnaissance de la filiation établie à l’étranger pourrait non seulement encourager l’exploitation des mères porteuses, mais aussi remettre en cause l’intégrité des principes fondamentaux du droit français qui, jusqu’à présent, ont cherché à protéger les enfants de la marchandisation de leur naissance.
Cette évolution juridique marque-t-elle un tournant vers l’acceptation de la GPA en France, sous forme de « filiation d’intention » ? Et surtout, peut-on vraiment parler de protection de l’enfant lorsque son existence est l’objet de conventions juridiques internationales ?
La France va-t-elle, en fin de compte, ouvrir la porte à un marché mondial de la procréation ?
Une question qui mérite, plus que jamais, une réflexion approfondie sur la place de l’enfant dans la société moderne.