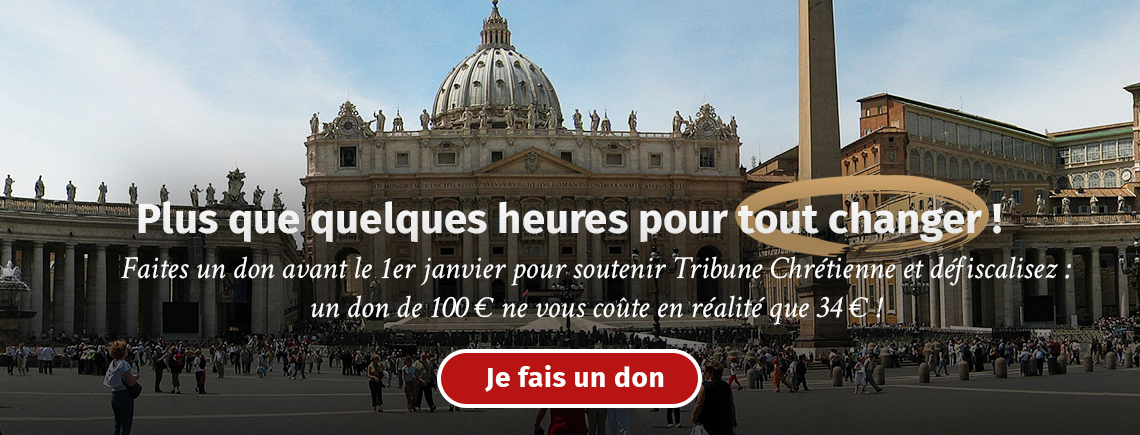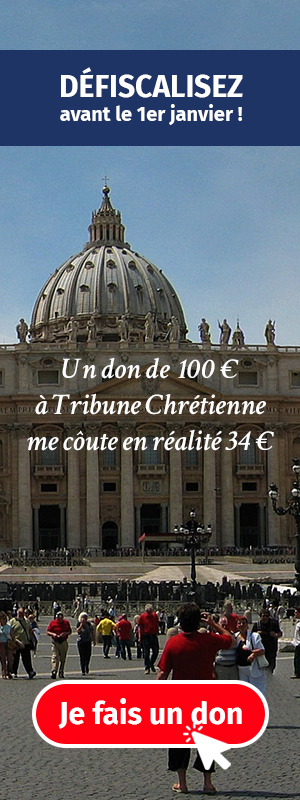Martyr (+ 303)
Le 23 avril, l’Église célèbre le glorieux saint Georges, soldat du Christ, martyr de la vérité, vainqueur du dragon, et protecteur de nations entières. Derrière la légende, il y a la foi inébranlable d’un homme qui, face à la tyrannie païenne, a choisi le Christ.
Il est des saints dont le culte dépasse les siècles, traverse les frontières et résiste aux scepticismes modernes. Saint Georges, martyr au début du IVe siècle, en est l’un des plus éclatants exemples. Sa vie historique est brève, son martyre est certain, et son souvenir est universel.
Originaire de Cappadoce et officier dans l’armée romaine, Georges sert avec loyauté l’Empire… jusqu’à ce que l’Empereur lui demande l’inacceptable : sacrifier aux idoles. En 303, sous Dioclétien, offrir de l’encens aux dieux païens devient une obligation. Mais Georges, chrétien fervent, choisit l’obéissance à Dieu plutôt que l’obéissance aux hommes. Arrêté à Lydda (aujourd’hui Lod, en Palestine), il confesse sa foi, refuse de se soumettre, et subit la torture avec une constance admirable.La tradition orientale le nomme « le Grand Martyr » — Megalomartyr — en raison de l’extraordinaire cruauté de son supplice : découpé en morceaux, plongé dans du plomb en fusion, brûlé dans un taureau de bronze chauffé à blanc, livré aux bêtes… À chaque fois, selon les récits populaires, Dieu le relève, et Georges multiplie les miracles devant ses bourreaux, jusqu’à ce que sa tête soit tranchée. Le sang du témoin rejoint alors celui des martyrs des premiers siècles, et l’Église tout entière en recueille la mémoire.
Très tôt, son culte s’étend. L’empereur Constantin lui dédie une église à Constantinople. Un siècle plus tard, on en compte déjà une quarantaine en Égypte. En Gaule, en Germanie, à Ravenne, les sanctuaires se multiplient. La France compte aujourd’hui plus de 80 localités qui portent son nom, et des centaines d’églises le reconnaissent pour patron.
Mais c’est au tournant du XIe siècle que la figure de saint Georges prend une dimension légendaire : le chevalier en armure affrontant un dragon pour sauver une ville et une jeune fille, symbole évident de la lutte du bien contre le mal, du Christ contre le démon. Cette image s’impose dans l’imaginaire chrétien occidental, notamment grâce aux croisades. Les chevaliers anglais, français, allemands choisissent Georges comme modèle. Sa bannière — croix rouge sur fond blanc — deviendra même l’emblème national de l’Angleterre, et son nom, celui d’un pays tout entier : la Géorgie.
Aujourd’hui encore, le 23 avril est férié dans certaines régions comme la Catalogne, où l’on célèbre saint Georges en offrant des roses et des livres. Il est le patron de l’Angleterre, de l’Éthiopie, de la Catalogne, de la Géorgie, et figure dans les armoiries de Moscou.Certains ont voulu douter de son existence, faute de sources précises. Mais l’Église, dans sa sagesse, ne mesure pas la sainteté à la rigueur des archives. Elle s’appuie sur la force d’un culte ancien et vivant, sur la mémoire d’un témoin du Christ dont le sang a fécondé la foi de millions.
Saint Georges est plus qu’un martyr : il est un drapeau, une armure, une épée tendue vers le ciel. Il incarne cette vérité simple et brûlante : nul n’a un amour plus grand que de donner sa vie pour Celui qui a vaincu le monde.
Avec nominis