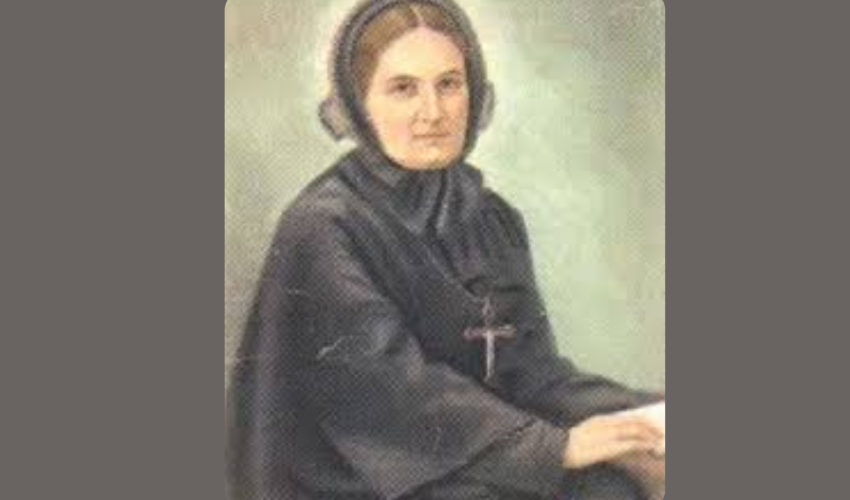Eugénie Smet naît à Lille en 1825 dans une famille chrétienne, marquée par une grande dévotion à la foi catholique. Très jeune, elle ressent un appel profond à se consacrer à Dieu et à répondre aux besoins spirituels des âmes du Purgatoire. En 1849, elle fonde à Lille un institut destiné à œuvrer pour les âmes souffrantes, une vocation qu’elle perçoit comme un devoir sacré. Cependant, c’est à Paris, en 1855, qu’elle sera véritablement appelée à mener à bien cette mission.
Le chemin vers la réalisation de son rêve de fonder un institut religieux n’est pas sans obstacles. L’institut qu’elle fonde, le futur Institut des Auxiliatrices des Âmes du Purgatoire, connaît des débuts difficiles, marqués par des épreuves et des incertitudes. Mais, fidèle à la Providence, Eugénie persévère. À Rome, après des années de travail acharné et de prières incessantes, elle obtient en 1865 l’autorisation papale pour son œuvre.
Elle oriente ses religieuses vers des missions variées, notamment les soins aux malades et aux pauvres, s’adaptant aux besoins urgents des plus démunis. L’apostolat des Auxiliatrices devient un modèle de charité active, où les sœurs œuvrent concrètement en faveur des malades, des pauvres et des âmes du Purgatoire.
Pie XII, dans son homélie lors de sa béatification, décrit ainsi la mission de la bienheureuse Eugénie :
« Que la charité envers les âmes souffrantes s’unisse intimement chez Eugénie Smet à l’apostolat le plus concret, le plus actif, le plus universel, voilà sans aucun doute un trait saillant de sa physionomie spirituelle. »
La fondatrice ne se contente pas d’un apostolat spirituel, mais incarne une véritable charité dans son approche concrète des besoins humains. Dès le départ, elle associe les laïcs à ses missions, en particulier à l’œuvre de soin aux pauvres à domicile, qui devient la principale activité de l’Institut. Ce mélange de dévotion spirituelle et de charité active constitue un modèle d’engagement chrétien qui, encore aujourd’hui, inspire de nombreuses communautés.
L’œuvre des Auxiliatrices du Purgatoire se distingue aussi par la façon dont elle tend à établir des liens entre les différentes classes sociales. Sœur Marie de la Providence voit dans sa mission un moyen de rapprocher les riches des pauvres, en leur offrant un terrain commun de charité et de service. Elle ne se contente pas de s’occuper des pauvres et des malades, mais cherche également à sensibiliser les plus privilégiés aux besoins de ceux qui souffrent, créant ainsi une véritable passerelle entre les extrêmes sociaux.
Le Pape Pie XII l’a béatifiée en 1957, soulignant l’importance de son œuvre et de son témoignage :
« Quelle bonté de Dieu envers l’Église… envers les malades pauvres et les pécheurs qui trouvent, dans ses membres, des servantes et des apôtres… envers les pauvres en inclinant vers eux le cœur des riches par l’intermédiaire de ce petit institut qui se pose comme un trait d’union entre les deux pointes extrêmes de l’échelle sociale. »
Décédée à Paris en 1871, Marie de la Providence laisse un héritage spirituel et social qui perdure. Son Institut des Auxiliatrices des Âmes du Purgatoire continue d’œuvrer pour les âmes souffrantes et les plus nécessiteux, tout en étant un modèle d’engagement chrétien dans la société. Son travail incarne cette vision chrétienne de la justice sociale qui place l’amour et la charité au cœur de toute action humaine. Aujourd’hui encore, son exemple guide les nombreuses sœurs et laïcs qui œuvrent dans son esprit pour une société plus juste et plus solidaire.
Avec Nominis