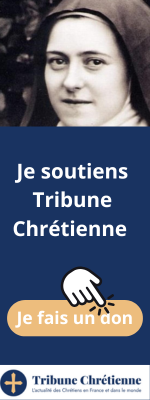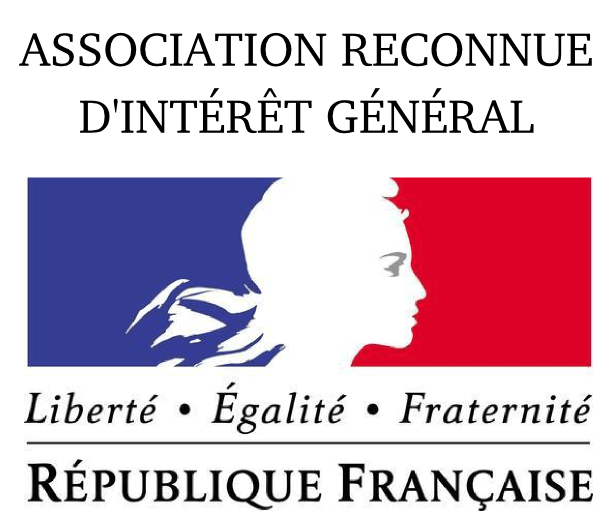La nomination de Sœur Simona Brambilla comme préfète du Dicastère pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique a été accueillie comme une première dans l’histoire de la Curie romaine. Aux côtés du cardinal Ángel Fernández Artime, désigné pro-préfet, cette configuration atypique reflète la volonté du pape François de remodeler la gouvernance vaticane. Pourtant, cette décision suscite des interrogations sur la portée réelle de cette nouvelle organisation.
Cette nomination marque-t-elle un réel changement ou reste-t-elle symbolique ?
L’idée d’un dicastère dirigé par une religieuse, une figure féminine non ordonnée, est inédite. Cependant, le rôle attribué au cardinal Artime, en tant que pro-préfet, questionne l’équilibre des pouvoirs. Traditionnellement, un préfet est le chef incontesté de son dicastère, mais la présence d’un cardinal dans une position dite « adjointe » brouille les cartes. Est-ce un véritable partage d’autorité ou une simple manière de maintenir une figure cléricale pour gérer les aspects nécessitant une ordination ?
À ce jour, aucune directive officielle n’a clarifié les prérogatives respectives de la préfète et du pro-préfet. La constitution apostolique Praedicate Evangelium, qui régit la Curie depuis 2022, ne prévoit pas de fonction spécifique de pro-préfet dans ce contexte, ajoutant à l’incertitude.
Le pape François, depuis le début de son pontificat, met en avant l’importance de la collaboration entre laïcs et clercs dans le gouvernement de l’Église. Pourtant, la nomination de Sœur Brambilla pourrait être perçue comme un geste avant tout symbolique, destiné à envoyer un « message d’inclusion » et de réforme, sans bouleverser en profondeur les structures hiérarchiques traditionnelles.
Lire aussi
En effet, si le pro-préfet Artime est amené à jouer un rôle déterminant dans la gestion des affaires exigeant un pouvoir sacramentel, comme l’approbation de constitutions religieuses ou la résolution de conflits entre clercs, la préfète pourrait se retrouver cantonnée à un rôle secondaire.
Historiquement, la gouvernance de l’Église a connu des périodes où des figures non ordonnées occupaient des rôles clés. Cependant, depuis le Concile Vatican II, le lien entre le pouvoir de gouvernement et le sacrement de l’ordre a été renforcé, limitant la place des laïcs dans les sphères décisionnelles.
La nomination de Sœur Brambilla, bien qu’elle brise ce schéma, soulève des doutes : est-ce une « avancée réelle » ou une simple adaptation des apparences ? Certains observateurs craignent que cette situation crée des tensions ou des blocages administratifs, faute de clarification sur les rôles.
Avec cette nomination, le pape François poursuit son chantier de réforme de la Curie, inspiré des modèles de gouvernance des ordres religieux. Cependant, cette initiative ne risque-t-elle pas d’amplifier les confusions plutôt que d’offrir une vision claire ? La question reste ouverte : Sœur Brambilla disposera-t-elle du pouvoir réel d’agir ou devra-t-elle s’appuyer constamment sur son pro-préfet cardinal pour légitimer ses décisions ?