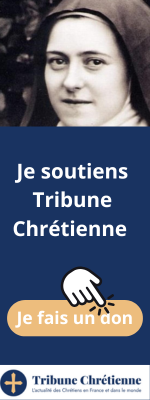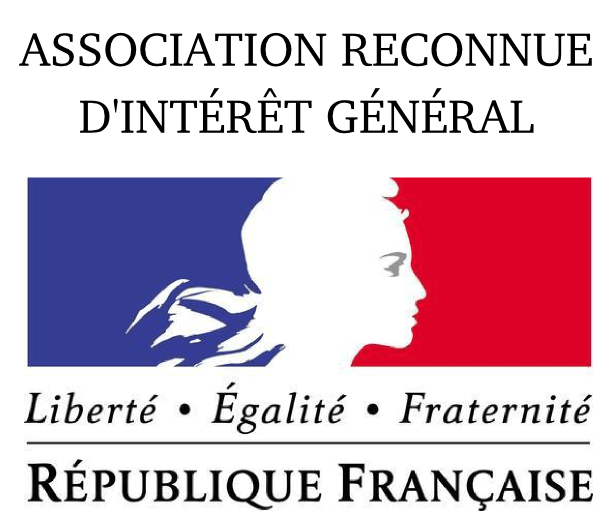Le 6 janvier, sœur Simona Brambilla est devenue la première femme préfète d’un dicastère de la Curie romaine. Théologienne et psychologue, elle dirige désormais le Dicastère pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique. Cette nomination, saluée par les médias comme une avancée historique, marque un tournant dans la gouvernance du Vatican.
Véronique Margron, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, a exprimé son enthousiasme dans un entretien à La Croix :
« Il était anormal qu’aucune femme n’ait ce niveau de responsabilité au Vatican. Cette nomination est un très beau signe, un soulagement pour toutes celles qui attendent que leur voix soit pleinement reconnue. »
Cependant, la nomination de sœur Brambilla soulève des interrogations. Le Pape François a, en effet, désigné le cardinal Ángel Fernández Artime comme « pro-préfet », suscitant des questions sur le rôle réel de sœur Brambilla. Pourquoi un préfet et un pro-préfet pour un même dicastère ? Certains y voient une manière de tempérer l’impact de cette décision auprès des milieux plus conservateurs.
Lire aussi
Le cardinal McElroy à Washington : un symbole progressiste
Dans le même temps, le Pape François a nommé le cardinal Robert W. McElroy archevêque de Washington, en remplacement du cardinal Wilton Gregory. Défenseur de l’inclusion LGBT et du diaconat féminin, McElroy est perçu comme l’un des principaux promoteurs de la réforme progressiste de l’Église. Cette nomination intervient alors que Donald Trump reprend la présidence des États-Unis, renforçant la symbolique de ce choix.
Pourtant, McElroy traîne un passif controversé : en 2016, il aurait ignoré les avertissements sur les abus de l’ancien cardinal Theodore McCarrick. Ce silence alimente les critiques de ceux qui jugent sa nomination incompatible avec les scandales qui ont ébranlé l’Église américaine.
Lire aussi
La démission de Monseigneur Rey : une fracture avec les milieux conservateurs et traditionalistes ?
Si les progressistes semblent favorisés, les évêques proches des sensibilités traditionnelles, comme Mgr Dominique Rey, subissent une pression grandissante. À la tête du diocèse de Fréjus-Toulon depuis 25 ans, Mgr Rey a été contraint de présenter sa démission. Rome lui reproche notamment son ouverture envers les communautés charismatiques et traditionalistes, et sa gestion jugée parfois trop indépendante.
Dans un entretien au Figaro, Mgr Rey a exprimé son amertume :
« Lors de ma dernière rencontre avec le Pape, en novembre, rien ne laissait présager une telle décision. C’est uniquement après mon retour que le nonce m’a informé de la volonté du Saint-Père. »
Malgré cette incompréhension, Mgr Rey a choisi d’obéir au Successeur de Pierre, tout en laissant transparaître la douleur d’un départ imposé. Son diocèse, avec ses séminaires pleins, était une rare exception dans un paysage ecclésial marqué par la crise des vocations. Ce dynamisme, paradoxalement, a attiré les critiques du Vatican.
Lire aussi
Les nominations de sœur Brambilla et du cardinal McElroy, face à la démission de Mgr Rey, illustrent une Église en pleine mutation. Tandis que François multiplie les gestes en faveur d’une gouvernance plus inclusive et d’un dialogue avec le monde contemporain, les sensibilités traditionnelles se sentent de plus en plus marginalisées.
Ces choix mettent en lumière une fracture croissante entre deux visions de l’Église. Alors que certains saluent ces décisions comme des avancées nécessaires, d’autres craignent qu’elles ne rompent le fragile équilibre entre tradition et modernité.
L’Église peut-elle évoluer sans perdre son identité ? Cette question, plus que jamais d’actualité, accompagnera les catholiques tout au long de cette année décisive.