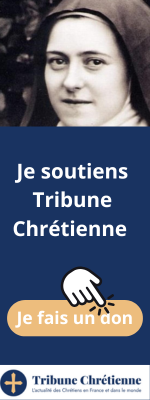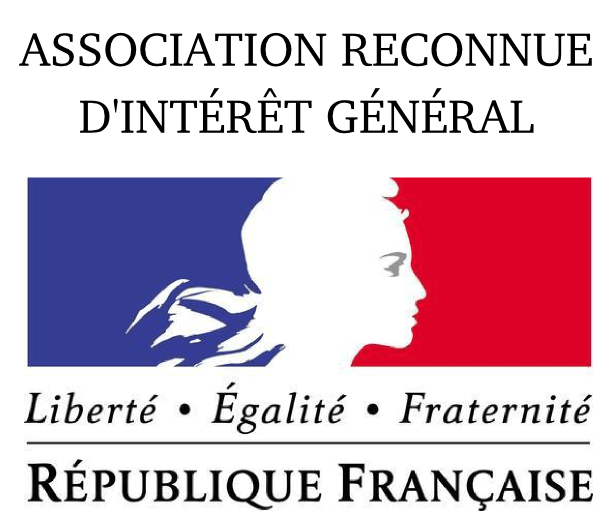Lors des fouilles archéologiques menées à la cathédrale Notre-Dame de Paris, les chercheurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) ont annoncé avoir découvert une sépulture qui semble correspondre à celle du poète, inhumé en 1560 sans qu’on connaisse. l’emplacement exact de sa tombe.
Au cours de ces fouilles, deux sarcophages en plomb anthropomorphes ont été exhumés à la croisée du transept. L’un d’eux a été identifié comme appartenant au chanoine Antoine de La Porte, tandis que l’identité du second, celui d’un homme d’une trentaine d’années, restait un mystère. Des analyses réalisées à l’institut médico-légal du CHU de Toulouse ont révélé des éléments frappants : la déformation de son os coxal indique qu’il montait à cheval, et des traces de tuberculose osseuse cervicale révélant une pathologie rare.

Joachim du Bellay (vers 1522 – 1er janvier 1560)
Eric Cubrézy, médecin et archéologue, a commenté cette découverte en disant : « C’était un cavalier émérite, il est allé de Paris à Rome à cheval, ce qui n’est pas rien quand on a une tuberculose comme lui. » Cette description correspond effectivement à la vie de Du Bellay, qui a vécu des voyages éprouvants malgré sa maladie.
Lire aussi
Né en Anjou, cofondateur de la Pléiade, Joachim Du Bellay est décédé dans le cloître de Notre-Dame de Paris. Sa famille avait souhaité qu’il repose dans la chapelle Saint-Crépin, mais lors de travaux en 1758, sa tombe n’avait pas été retrouvée. Aujourd’hui, bien que l’identification semble solide, Christophe Besnier, responsable des fouilles, a précisé : « Il reste des doutes », notamment en ce qui concerne l’analyse des isotopes qui suggère une enfance passée en région parisienne.
Cette découverte s’inscrit dans un contexte de fouilles intenses après l’incendie de Notre-Dame en 2019, qui a révélé de nombreuses autres sépultures et artefacts, tels que près de 1 000 fragments de jubé. Les archéologues continuent d’explorer ces vestiges, espérant en apprendre davantage sur l’histoire de ce monument emblématique et de ses illustres occupants.
« Les Regrets » contenant le sonnet le plus célèbre de son œuvre
Il écrit ce poème durant son voyage à Rome entre 1553 et 1557 et publié en 1558. Composé de 191 sonnets en alexandrins, cet ouvrage se démarque par son choix de mètre et aborde principalement la mélancolie lié à l’éloignement de son pays natal, plutôt que l’amour d’une femme, contrairement au modèle pétrarquiste.
Le recueil se divise en trois tonalités : l’élégie (sonnets 6 à 49), la satire (sonnets 50 à 156) et l’éloge (sonnets 156 à 191). Inspiré par le mythe d’Ulysse, du Bellay évoque son désir de retour tout en observant les défauts de la société française à son retour de Rome. Parmi les sonnets, l’un d’eux est particulièrement célèbre et illustre l’essence de son œuvre.
| Heureux qui, comme Vlyſſe, a fait un beau uoyage, Ou comme ceſtuy là qui conquit la toiſon, Et puis eſt retourné, plein d’uſage et raiſon, Viure entre ſes parents le reſte de son aage ! Quand reuoiray-ie, helas, de mon petit uillage Fumer la cheminee, et en quelle ſaiſon, Reuoiray-ie le clos de ma pauure maiſon, Qui m’eſt une province, et beaucoup d’auantage ? Plus me plaiſt le ſeiour qu’ont baſty mes ayeux, Que des palais Romains le front audacieux: Plus que le marbre dur me plaiſt l’ardoiſe fine, Plus mon Loyre Gaulois, que le Tybre Latin, Plus mon petit Lyré, que le mont Palatin, Et plus que l’air marin la doulceur Angeuine. | Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, Ou comme celui-là qui conquit la toison, Et puis est retourné, plein d’usage et raison, Vivre entre ses parents le reste de son âge ! Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village Fumer la cheminée, et en quelle saison, Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, Qui m’est une province, et beaucoup davantage ? Plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux, Que des palais romains le front audacieux, Plus que le marbre dur me plaît l’ardoise fine, Plus mon Loire gaulois, que le Tibre latin, Plus mon petit Liré, que le mont Palatin, Et plus que l’air marin la douceur angevine. |